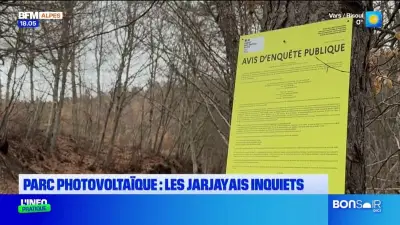La fracture éthique entre minimalistes et maximalistes
On raconte souvent que l'humanité se divise entre ceux qui creusent et ceux qui tiennent le flingue. En réalité, elle se sépare surtout entre ceux qui croient à une division binaire et ceux qui constatent, après près de quatre millions d'années d'évolution, que l'humanité est fondamentalement une affaire de pluralité. Notre espèce est mouvante, contradictoire, irréductible au simplisme des grandes catégories, surtout lorsqu'elles se limitent à seulement deux.
Une ligne de fracture persistante
Pourtant, une ligne de fracture profonde persiste dans nos sociétés. Elle isole du reste de la population les individus capables de tolérer que d'autres vivent différemment d'eux. Cette séparation oppose ceux qui vivent pour ne rien avoir à demander à personne et ceux qui ne supportent pas que le monde, ainsi que leurs congénères, leur échappe.
Cette distinction fondamentale a été magistralement formulée par le philosophe Ruwen Ogien, dont l'absence se fait cruellement sentir dans une époque toujours plus avide de resserrages idéologiques. Ogien opposait les minimalistes aux maximalistes. Les premiers estiment que la morale se limite à une exigence simple : ne pas nuire à autrui. Les seconds, au contraire, veulent définir le bien, le vrai, le juste, et organiser la vie des individus en conséquence, quitte à les « sauver » malgré eux.
La modernité et l'expansion de l'autonomie
Si ce clivage remonte probablement à l'âge des cavernes, la modernité a offert aux « libertaires » un écosystème infiniment plus favorable à leurs inclinations. Pour ne rien avoir à demander à personne et échapper aux contraintes étouffantes du « commun », il faut pouvoir se le permettre. La civilisation issue des Lumières a créé une boucle de rétroaction positive entre désir d'autonomie et moyens d'autonomie, permettant à cette niche de grossir comme jamais auparavant dans notre longue histoire collective.
Le débat sur la fin de vie comme illustration
La loi française sur la fin de vie, et les faux débats qui l'accompagnent, constitue une nouvelle illustration de ce conflit archaïque. Chaque fois que s'ouvre la possibilité de laisser des individus disposer de leur propre corps – pour donner la vie, la refuser, la transformer ou y mettre un terme – surgit la même litanie d'arguments, comme sortie d'un grenier idéologique poussiéreux.
On nous parle inlassablement de dérive, de pente glissante, de bascule civilisationnelle, de risque de normalisation, de pressions invisibles mais omnipotentes. On convoque les plus vulnérables, fragiles et impressionnables pour justifier qu'on interdise à tous ce que certains pourraient mal manier. Cette argumentation repose sur une confusion systématique entre la possibilité d'un abus et sa nécessité.
Une structure mentale rigide
Cette position révèle toujours la même structure mentale : si quelqu'un est autorisé à choisir, alors quelqu'un, quelque part, finira par être contraint. Si une liberté existe, elle deviendra forcément une obligation. Comme si l'autonomie ne pouvait qu'être universellement partagée ou universellement supprimée, sans possibilité de nuances.
En réalité, cette peur obsessionnelle du précédent, du cliquet, du « et après ? » dit moins quelque chose de la fin de vie que de la difficulté à appréhender la signification et l'effet véritables du pluralisme. Elle trahit une incapacité profonde à admettre que des individus puissent faire des choix radicalement différents face à une même situation – la souffrance, la dépendance, la mort – sans que l'un invalide l'autre.
La dignité comme affaire subjective
Cette vision rigide refuse de reconnaître que la dignité n'est pas une norme unique, mais une affaire située, subjective, intime. Elle ignore qu'entre une liberté absente et une liberté offerte, le lien de causalité est autrement plus solide chez ceux que l'absence entrave que chez ceux que la possibilité astreint.
Le corps, territoire toujours contesté
Certains objecteront que la mort n'est pas une affaire privée, qu'elle engage la société, la médecine, le lien social. Cet argument est imparable car extensible à l'infini : la sexualité aussi engage la société, la famille, la symbolique collective ; la reproduction également ; le corps des femmes en général n'a jamais cessé de « poser problème » aux yeux de certains.
À ce compte-là, il n'existe à peu près rien qui ne puisse être déclaré d'intérêt public, et donc réglementé jusqu'à l'asphyxie. Cet éternel retour des mêmes arguments n'est pas le signe d'une vigilance morale, mais d'un refus obstiné de tirer les conséquences de la diversité humaine.
Tant que ce refus persistera, la liberté de disposer de son corps restera ce qu'elle a toujours été : un scandale pour ceux qui rêvent de tenir le flingue pendant que d'autres creusent leur propre chemin. Cette tension fondamentale entre minimalistes et maximalistes continuera de structurer nos débats sociétaux les plus cruciaux, révélant au passage notre capacité ou notre incapacité à vivre avec la pluralité humaine.